|
index le webmestre contact |
Bulletin
de l’association des personnels de la
« 5 »
|
New’s… N° 67
|
|
index le webmestre contact |
Bulletin
de l’association des personnels de la
« 5 »
|
New’s… N° 67
|
|
L’armée de l’Air a subi à Albacete un drame terrible qui nous a tous marqué. L’AP 5 a été présente par ses témoignages à tous les niveaux et je veux vous citer l’ordre du jour du Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air Ordre du jour n° 39 Ils partaient aux avions.
Pilotes, navigateurs et mécaniciens. Ce 26 janvier 2015, à
Albacete, ils partaient aux avions quand le ciel
qu'ils s'apprêtaient à gravir s'est brutalement et
définitivement obscurci. Vous avez réalisé votre
devoir en même temps que votre passion, en cette
date fatidique à l'instar de tous les autres jours
que vous avez passés au sein de l'Armée de l'Air. Honorant leur mémoire, unis par leur vertu, forts de leur courage, nous ferons face aux défis que nous réserve le destin, pour le succès des armes de la France. |
|||||||||
|
Nous avons perdu
Michel Giraud le 10 janvier 2015. Vous retrouverez cet article ci-dessous mais auparavant voici la carrière de Michel.
Descendant d’un marin qui avait combattu à Trafalgar et avait vécu 10 ans sur un ponton de sa gracieuse majesté, arrière-petit-fils et petit-fils de capitaine au long cours en Méditerranée et sur toutes les mers du globe, fils d ‘un colonel d’infanterie, Michel a choisi la troisième dimension tout en conservant au fond de son cœur, l’héritage de ses origines, la mer et Bandol son fief où il était né entouré de 5 sœurs. Plutôt bagarreur, sa forte personnalité et son amour de la France le pousse à rentrer dans l’Armée de l'Air. Il est formé au Maroc et
affecté à la 4eme Escadre de chasse et à
l’escadron "La Fayette" à Friedichshafen en
Allemagne sur Vampire puis sur Ouragan. CP en
1957, il décide pour différentes raisons de
rejoindre l’entreprise familiale pendant deux
ans. Cependant depuis son départ de l’AAir il était «défroqué» et à l’appel des grands espaces, il a rejoint la 5ème Escadre de chasse à Orange. Un séjour en Algérie et il est au 1/5 dans un superbe escadron de guerriers sous les ordres d’un chef charismatique le Cne Tourniaire. Jusqu'à son départ de l’AAir il a formé les jeunes pilotes que nous étions, il nous a dispensé son expérience, nous insufflant l’amour du métier de chasseur. Son surnom était le "Fifre" par un mauvais jeu de mots comme nous en avons dans la chasse, car dans ses responsabilités d’officier de tir, il avait des sous-fifres tels que Jean Loup Chrétien, il était donc devenu le "Fifre". C’était aussi l’époque des amitiés fortes, nous habitions tous Fourches vielles, cette cité du nord d’Orange, avec cette vie de copains d’escadron en semaine, avec ces rencontres familiales le week-end, avec Nicole et les filles Catherine et Marie Hélène, à la découverte de la Provence qu’il connaissait par son cœur. Puis le temps est venu pour lui de quitter ce métier qui était toute sa vie pour une seconde carrière dans le civil. Après trois ans sur des trapanelles, il rejoint Air Inter, prends des responsabilités, crée le service de sécurité des vols, introduit le CRM dans la compagnie, et devient chef de secteur Airbus A 300 puis il quitte la compagnie tout en assurant pour Air France la responsabilité de la formation des jeunes élèves au simulateur. Vient maintenant le temps de revenir en arrière, le temps pour Michel de retrouver la mer sa seconde passion. C’est le temps d’une transatlantique d’une Trans Pacific pour aller s’incliner aux Marquises sur la tombe de Jacques Brel (dans le prochain N°, il nous contera son arrivée aux Marquises), le temps aussi des vacances avec les copains sur le Mercure un first 30 puis sur un First 38 c’est le temps des plongées kamikazes en Corse, le temps de l’amitié profonde et de la confiance totale en notre capitaine. Le temps aussi de son installation à Bandol dans la maison familiale face au port de Bandol où il renoue avec son enfance, avec ses copains aviateurs et avec les autres, avec toujours la même chaleur humaine, la même droiture, la même attention aux autres et la volonté de ne pas blesser mais de convaincre.
|
|||||||||
|
REFLEXIONS sur la FORMATION de Base PARCOURS PERSONNEL 1973 - Pour m’être fait «descendre en flammes» trois fois à ce damné Brevet théorique de Pilote de ligne, j’en connais très bien les difficultés lorsque l’on ne dispose que de cours par correspondance. Le but final : réussir «dignement» aux épreuves du P.L pratique ; soit : une séance de «Tricot» sans passager (PAX) autour d’un terrain et un courrier international pax à bord. Je dis «dignement», parce que pendant les pauses, le contrôleur DGAC doit s’assurer que le niveau du P.L théorique est mis en pratique, par exemple vérifier les limites actualisées du domaine de vol à basse et haute altitude : utilisation permanente de la fameuse courbe k CZM² f(M) - à consulter, une fois dans sa vie, le fascicule A.F "Le Vol à Haute Altitude" ; notre éminent confrère P.ENAULT (Promo 53 de l’Ecole de l’air) en a été l’un des rédacteurs. 1953 - De mon temps, le niveau des connaissances enseignées à Marrakech, Meknès, Avord était vraiment rudimentaire. Par exemple : l’incidence ? C’est l’arlésienne, on ne la verra pas ; donc augmentons la vitesse a priori… Il faudra attendre le H.U.D. (Pilotage tête haute) pour voir à la fois le vecteur vitesse, l’INCIDENCE, la Pente, la HAUTEUR, etc., le tout en observant le paysage dans la glace avant ! La
guerre d’Algérie, après « x » décrochages
mortels à "bonne vitesse", verra l’apparition de
l’incidencemètre du «pauvre» : une alarme
sonore seulement ! Et pourquoi pas un
indicateur d’incidence pour prévenir le pilote
que l’alarme va sonner ? Ceci dit : si une sonde-anémo givre, les fentes des sondes qui captent l’incidence peuvent givrer aussi. Toutefois les « palettes » Giannini givrent moins facilement L’ADHEMAR du Mirage III a fait faire un pas en avant. Sur un avion de ligne un indicateur chiffré sur la planche de bord n’aurait pas coûté grand-chose, puisqu’il y avait déjà un capteur et un calculateur pour l’Alarme de décrochage réglementaire. Mais une fois encore "on"’ a pris les pilotes pour des primates du néolithique ! Rappel : Tous les avions d’AIR INTER étaient équipés d’un INCIDENCEMETRE. Lorsque la mort dans l’âme nous avons transmis nos avions à AIR FRANCE, incidencemètres et HUD de l’ A 320 ont étés démontés, pour standardiser la flotte, et surtout parce que le HUD coûte cher. L’enquête de l’A 330 de RIO repose le problème pour l’incidencemètre. Pendant la chute de l’avion l’alarme de décrochage sonnait. Les membres de l’équipage croyaient peut-être à une conséquence de la panne initiale... Respectons-les ! Autre digression : Par contre, AIR INTER a eu tort de rejeter le G.P.W.S. parce que la première génération était "farcie" de fausses alarmes ; les améliorations ont été trop lentes. Exemple : La carte d’approche A.F portait, à la verticale du Mont Sainte-Odile, un sigle indiquant : ‘’Ne pas tenir compte de l’alarme GPWS.’’ Ici encore j’ai bataillé dans mon Secteur de vol pour que les équipages consultent les INFOS PRIMAIRES. Celles du GPWS étaient, à 80% issues des Radios-Altimètres. Au Secteur A 300, à 2000 ft, l’équipage annonçait : "RADIO ALTIMETRE : ACTIF". Sur A 320 les R.A. du HUD démarraient à 7000 ft. N.B. : Le CDB REBUFFET utilisait aussi cette méthode, et c’est une référence pour moi. Cependant
l’accident du Mont Sainte Odile est dû à bien
d’autres causes. Arrivée en Escadre : La REVELATION, pour moi, ce fut lorsqu’un certain lieutenant Michel FORGET, de son fief de sa deuxième escadre académicienne, nous adressa un précieux fascicule de «MECAVOL de l’avion à réaction». Je l’ai conservé pieusement. J’ai découvert aussi, endormie dans la bibliothèque de l’Escadre, une merveilleuse collection de livres de navigation avec schémas en couleur : la Terre, les cartes, la "Navigation du pilote", la "radio navigation". Ces fascicules cartonnés étaient démontables, ce qui laissait attendre des mises à jour futures. Mais hélas, il n’y eut jamais de mises à jour de ce beau travail sur la formation de base. Arrivée dans l’Aviation Civile : 1969 - Découverte du programme du P.L théorique. Première réflexion : "Comment ai-je pu voler en ignorant tout ça"? Il
m’a fallu des années de travail acharné pour me
mettre au niveau. Je parle de mon cas personnel,
les anciens de l’E.A n’ont mis qu’une année pour
réussir au P.L. Un exemple concret 1967 - Gilbert PAGNOT, qui vient de rejoindre le ciel des "grandes chasses", était le plus doué des "branleurs de manche" de notre génération. Un jour, je remplace "PAGNOT-le-taciturne" à la surveillance des vols Mirage III C. J’avais 100 heures de vol sur Mirage, il en avait plus de 1000 (non effectuées dans les "rues sans joie" des AIR-WAYS). PAGNOT était plongé dans l’étude d’un manuel. Devinez-en le titre : "MECANIQUE du Vol du Supersonique" de l’EPNER. Même les pilotes ayant un exceptionnel instinct de chat sauvage peuvent s’appuyer avec succès sur quelques connaissances simplifiées pour être efficaces en vol. 1985 - Après avoir constaté que 65% des accidents aériens étaient causés par une mauvaise gestion des fameux "Facteurs humains", les Flights Safety Anglo-saxons puis Air-France s’attaquent au "Cockpit Ressources Management" (CRM) qui s’étendra au "CREW Ressources Management" (Equipage : PNT + PNC), puis au "Compagnie Ressource Management" (Personnel Sol), puis aux relations avec les Contrôleurs aériens. Donc la DGAC ajoute un certificat CRM au P.L théorique. Je
vois là un gros problème pour concilier CRM et
organisation militaire. Mais CRM ne signifie pas
la disparition du chef / responsable, remplacé
par un "Soviet de subordonnés". Ce qui me semble
le plus important c’est que ce délicat sujet
soit étudié. Ma première conclusion : La
quatrième année de L’E.A sera peut-être
délocalisée pour l’étude en commun des problèmes
soulevés par le P.L théorique. Ceci ne veut pas
forcément dire que l’E.A va devenir un tremplin
pour abandonner, d’aucuns diront "déserter"
notre Armée de l’Air. Au train où vont les coupes sombres du "Livre Blanc", il y aura de plus en plus de départs contraints et forcés vers l’Aviation Civile. Toutes ces formations de base sont payées par l’Etat, donc par nous, les contribuables. Il me semble inéluctable qu’un jour il faille regrouper aussi ces budgets. Quand la Marine Nationale (bien sûr) se verra confier cette "Mission historique", le Charles De Gaulle aura cessé de naviguer. Car cela va demander "un certain temps"… Notre Marine aura naturellement perdu son LEADERSHIP (pour utiliser en conclusion le vocabulaire CRM) avec la mise à la ferraille de son ‘’enfant prodigue’’ ; alors je lui souhaite bien du plaisir ! Michel GIRAUD |
|||||||||
|
Quelques mots sur les nouvelles aventures du PA Le groupe aéronaval, autour du porte-avions Charles-de-Gaulle, a quitté Toulon pour se rendre dans le Golfe, où ses avions participeront aux frappes en Irak. Le départ a été prévu juste après que le président de la République y eut présenté ses vœux aux armées, lors d'une cérémonie à bord (La guerre des marins peut attendre, l’Armée de l'Air est au combat). Le Charles-de-Gaulle devrait rester plusieurs mois «sur zone» (quelques jours à l’entrée du golfe persique et beaucoup plus de temps en croisière dans l’océan indien, chut c’est une mission diplomatique importante !) et ses Rafales prendront la relève de ceux de l'armée de l'air, basés aux Emirats . (pour être plus précis et plus exact les Rafale Marine exécuteront quelques missions si les américains autorisent le PA à rentrer dans le golfe persique, quant à relever les Rafale Armée de l'Air pourquoi attendre 15 jours de transit alors qu’un trajet sur la base 104 leur aurait permis d’être opérationnel sans délai. Nous ne sommes pas dans le même monde) Les marins se réjouissent de cette décision, qui a été confirmée à la suite de la récente visite du ministre de la défense à bord (C’est le dernier salon où l’on cause). Depuis la campagne de Libye (Harmattan), les marins se sentent en effet un peu les parents pauvres des opérations, que ce soit au Mali, dans le reste du Sahel, en Centrafrique ou en Irak. Et pourtant c’est facile il suffit de mettre les Rafale Marine sur une Base aérienne mais comment justifier le PA ??? |
|||||||||
|
Comme le rappelle le général Caubel auteur d’une conférence dont j’ai transcrit ci-dessous une partie, 2014 a été une année forte pour l’Armée de l'Air, mais aussi avant de refermer la page, c’est l’anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu. Le général Caubel abattu au-dessus du camp retranché a déjà publié dans l’AP 5 New’s N° 53 cet épisode de sa vie Cette année 2014 est fertile
en anniversaires, la première guerre mondiale,
un siècle,… le débarquement en Normandie, 70
ans… la création des Forces Nucléaires
Stratégiques nationales, cinquante ans,…
Dien-Bien Phu et la fin de la guerre française
au Vietnam, soixante ans ! Ce dernier
anniversaire, que nous célébrons aujourd'hui,
peut aussi être désigné comme celui de la Fin
d'un Siècle de Présence Française en Indochine.
Cela vaut la peine de s'y arrêter. Mais au lieu de gémir comme le font certains dans une repentance anticoloniale que rien ne justifie, ce sera pour rappeler tout ce que cette présence française a apporté à l'Indochine. Dans ce pays encore moyenâgeux la France a construit des routes, des voies ferrées, des barrages... La France a introduit des services médicaux, créé des hôpitaux, mis sur pieds deux Instituts Pasteur, l'un à Saïgon, l'autre à Nha-Trang… Auparavant, depuis plus de quatre siècles, les missionnaires français avaient déjà commencé la "Romanisation" de la langue écrite, c’est-à-dire la transcription de la langue écrite vietnamienne avec des caractères latins, les nôtres. Ils avaient créé ainsi un outil irremplaçable pour le développement social et intellectuel du pays. Les écoles ont suivi, puis l'Université de Hanoï. La France a ainsi réalisé toutes les infrastructures et tous les outils nécessaires à un essor économique, social, sanitaire,… ainsi qu'un accès de tous à la connaissance intellectuelle et à la culture. Cela a permis un essor sans équivalent dans toute la zone du Sud-est asiatique ! En huit ans de guerre, le Corps expéditionnaire Français a perdu 40 000 soldats. 40 000 vies données pour la défense de la liberté face à une idéologie totalitaire dont nous avons vu depuis l'effondrement et le triste bilan en Europe. Vous, mes amis anciens de Dien-Bien-Phu, vous avez été les acteurs du dernier combat. Pour reprendre le mot célèbre d'Henri Guillaumet, aviateur perdu dans la Cordillère des Andes, nous pouvons vous dire : "Ce que vous avez fait, aucune bête au monde ne l'aurait fait" ! Aujourd'hui, dans la quiétude de leurs bureaux, des politiciens de rencontre, dont certains dénués de toute morale, ne cessent de nous ressasser les valeurs de la République !... Certes, nous devons respecter les valeurs de la République… Mais vous, ce dont vous avez donné le témoignage ce sont des valeurs fondamentales de la personne humaine. Vous avez témoigné de votre courage, de votre droiture, de votre fidélité à l'engagement, de votre abnégation et votre don de soi… L'ensemble de ces valeurs, ça s'appelle l'honneur. Soyez fiers de ce que vous avez fait ! Mais, nous avons laissé là-bas nos camarades, nos amis. Que leur souvenir reste ancré dans notre mémoire, ancré dans le fond de notre âme, à jamais ! Tous ici, nous sommes réunis pour célébrer leur mémoire. Pierre CAUBEL
|
|||||||||
|
L’Armée de l'Air publie une revue nommée Epidosis. Le texte ci-dessous est le verbatim d’un article paru récemment ou le rédacteur en chef laisse parler un ancien, pilote pendant la 2nde Guerre mondiale et Compagnon de la Libération, PAUL IBOS. Merci au Colonel Bruno Mignot et à son chef le général Patrice Sauvé ancien commandant de la base de Seynes de nous avoir autorisés à publier cette interview Né
le 18 août 1919 d’un père officier général
d’infanterie de marine, Paul Ibos suit une
formation d’observateur comme élève-officier de
réserve lorsque la Seconde guerre mondiale
éclate. Alors qu’il est affecté au Centre
d’instruction du bombardement de Toulouse depuis
mai 1940, il refuse la défaite de la France,
rejoint Londres via l’Espagne et
le Portugal, et s’engage dans les Forces
aériennes françaises libres (FAFL) fin août
1940. Dès lors, il contribue, au sein du groupe
de bombardement « Lorraine », une des premières
unités aériennes gaullistes, à la reprise de
l’initiative de la France libre dans les
colonies françaises d’Afrique et du
Proche-Orient aux côtés des Britanniques. Il est
breveté pilote en octobre 1942. En janvier 1943,
il rentre en Angleterre et participe aux
opérations en Europe comme navigateur du chef
d’escadrille. Blessé au cours d’une mission
aérienne, le capitaine Ibos est affecté à
l’état-major des FAFL, d’août 1944 à la fin de
la guerre. Muté au Groupe de transport 1/15 «
Touraine » en juillet 1945 en qualité d’officier
de renseignement avant d’être démobilisé en mars
1946, il totalise 74 missions de guerre. Ses
actions autant en vol qu’au sol sont saluées par
l’attribution de la Croix de guerre et par trois
citations à l’ordre de l’armée. Le 20 novembre 1944, il est fait Compagnon de la Libération. Détenteur de la médaille coloniale (aujourd’hui médaille d’outre-mer) avec l’agrafe «Libye», il est fait Commandeur de la Légion d’honneur en 1996. Il a fait honneur à la rédaction d’Epidosis en répondant à ses questions. Alors que beaucoup étaient stupéfaits et démoralisés par l’appel du maréchal Pétain à cesser le combat, dans quelle disposition étiez-vous en ce 17 juin 1940 ? Avant ce discours, au Centre d’instruction de bombardement (CIB) de Toulouse, on ressentait un esprit défaitiste. Le discours de Pétain nous a navrés. Le Maréchal n’avait pas une figure d’icône dans la famille qui était pourtant très militaire. Mon père avait fait Saint-Cyr, puis la guerre du Maroc en 1910, puis la guerre de 14-18 et ensuite la campagne du Maroc en 1926. Mon frère aussi avait fait Saint-Cyr. Personnellement, moi qui ne connaissais que le milieu militaire, j’envisageais initialement de faire autre chose, comme travailler dans le secteur civil, dans le monde de l’entreprise. Mais, en 1939, à la veille de la guerre, je prépare l’École de l’air et je décide de signer un engagement volontaire dans l’armée de l’air. Mon père m’avait déconseillé de faire la coloniale. Pour lui, l’époque des militaires était finie, c’était le temps des administrateurs. Quand il a su que j’allais m’engager dans l’armée de l’air, il s’est montré très satisfait et m’a encouragé. En juin 1940, on a eu vent de ce qu’il se passait quelque chose en Angleterre. On ne parlait pas encore de De Gaulle, mais on savait qu’un officier cherchait à rassembler du monde pour poursuivre la lutte. Au CIB de Toulouse, un officier avait recensé le nom des volontaires pour continuer le combat hors de France. A l’époque, beaucoup de gens étaient intéressés par l’idée, mais ils n’ont pas donné suite parce que rejoindre l’Angleterre était déjà un défi. Beaucoup ont donc baissé les bras. Pas moi ni deux de mes camarades qui avons décidé de tenter l’aventure. Comment, quand on a à peine vingt ans, quand on vit les heures les plus sombres que peut connaître sa patrie, trouve-t-on le courage et la force de résister à une situation qui paraît désespérée ? Quand on a vingt ans, on ne réfléchit pas. Je m’étais engagé pour la durée de la guerre et elle n’était pas finie. On n’envisageait évidemment pas d’arrêter ! Ça ne m’a même pas traversé l’esprit ! Non, cela ne pouvait pas finir comme cela. Alors, il a fallu trouver un moyen pour rejoindre l’Angleterre. La suite a été rocambolesque. Quelques semaines plus tôt, à l’heure des combats, je m’étais rendu avec un détachement du CIB à Port-Vendres pour embarquer vers l’Afrique du Nord et pour continuer le combat(1). Mais avec le cessez-le-feu, un général vichyste plein d’énergie avait mis une barrière de militaires pour empêcher d’embarquer. Avec deux camarades, nous avons alors cherché un autre moyen pour quitter la France. Nous avons rencontré un commandant polonais qui devait rembarquer avec son unité. Il nous a pris sous son aile et nous a fourni de faux papiers d’identité. Je suis ainsi devenu le « podporucznik »(2) Victor Palma. Au bout de quinze jours, on a appris que le navire ne viendrait pas et qu’il faudrait se débrouiller tout seul. A Perpignan, le consulat polonais nous a alors donné un passeport polonais. Mais, pour passer en Espagne puis au Portugal, il fallait donner à ces pays la garantie que l’on ne resterait pas chez eux. Pour obtenir le visa espagnol, il fallait un visa portugais et le Portugal nous donnait un visa si l’on pouvait prouver que l’on quittait leur pays. Il a donc fallu en premier lieu trouver une destination à Lisbonne et avoir la preuve qu’on embarquait. Shangaï s’est avéré être la seule destination possible pour assurer notre couverture. Le consulat de Chine à Marseille nous a ainsi fourni un visa. Le 16 août, arrivés à Lisbonne, on a repris notre identité pour embarquer pour l’Angleterre après avoir rejoint Gibraltar car les convois escortés vers l’Angleterre partaient du Rocher. J’ai fait tout ce périple sans
en informer mes parents. Je voulais leur éviter
des ennuis, d’autant plus qu’on disait que les
militaires qui avaient rejoint Londres étaient
condamnés à mort. La construction des Forces aériennes françaises libres, en rupture avec l’armée de l’air d’armistice, obligeait à trouver les moyens de se réorganiser à partir de très peu de choses, non ? Oh vous savez, je n’étais qu’un pion parmi les FAFL même si on était très peu nombreux ! Seulement cinq à six pilotes de chasse français ont participé à la bataille d’Angleterre en étant directement intégrés dans les squadrons de la Royal Air Force. Quand je suis arrivé en Grande-Bretagne, on commençait à se structurer à partir de pratiquement rien. Tout était très désorganisé par la force des choses. A l’école de pilotage d’Odiham, les Britanniques n’avaient pas le temps de s’occuper de nous. En deux mois, on a à peine volé. Henri Labit, un camarade, a préféré devenir parachutiste. Il a intégré le Service de renseignement de la France libre(3) mais, en mission en France, il a dû avaler sa capsule de cyanure pour ne pas être capturé vivant par l’ennemi... Puisqu’il ne se passait rien à Odiham, que l’on était las de rester inactif, les Anglais nous ont remis à la disposition des FAFL. L’idée des FAFL était d’essayer de former une escadrille en Afrique. Le gouverneur d’Afrique équatoriale française, Félix Eboué, s’était alors rallié à De Gaulle peu de temps auparavant. On est donc parti pour l’Afrique, mais sans projet du tout, ni sans savoir ce que l’on y ferait. Arrivés à Pointe-Noire, en février 1941, on a appris qu’il y avait des avions Glenn Martin à Takoradi. Seulement, ils étaient encore en pièces détachées dans des caisses livrées quelque temps plus tôt. Les Anglais nous ont donné l’autorisation de s’en servir, après que leurs mécaniciens les ont eu assemblés. Ainsi, s’est formée une petite escadrille commandée par le commandant Goumin. Je faisais équipage avec le lieutenant Ezanno, pilote, ainsi que Borel et Aubéry.
1. NDLR : au milieu du mois de juin 1940, le gouvernement français décide de passer ses forces vives en Afrique du Nord pour continuer la lutte. Le paquebot Massilia doit embarquer nombre de députés et de de sénateurs vers l’Algérie ou la Grande-Bretagne, alors que, dans la tourmente de la débâcle, le Parlement vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain et qu’est signé l’armistice. Peu auparavant, une grande partie de l’aviation militaire française, soit 575 chasseurs modernes, 300 bombardiers et 200 avions de reconnaissance avaient déjà franchi la Méditerranée (Il y a ceux qui se sabordent et il y a les autres) 2. NDLR : grade de sous-lieutenant dans l’armée polonaise. 3.
NDLR : futur Bureau central de renseignements
et d’action (BCRA). Les pilotes ont commencé à voler sur cet avion qu’ils ne connaissaient pas, faisant quelques tours de piste pour prendre l’avion en main avant un lâcher très rapide. Et comme les Glenn Martin n’avaient aucun équipement de navigation, on est parti à Damas en convoi de six ou sept avions en passant par Fort Lamy, El Fasheer et Karthoum. Notre avion est resté en rade à El Fasher. On a rejoint nos camarades plus tard en avion taxi. Pendant ce temps, le commandant Goumin, arrivé en premier, a été porté disparu après une mission au-dessus de la Crète. Le commandant de Marmier a pris le commandement de l’escadrille qui suivait de près les opérations en Cyrénaïque. Le front était peu actif à cette époque, mais je me rappelle que les Glenn Martin, qui étaient équipés de circuits électriques très affinés, ne supportaient pas le sable : qu’est-ce qu’on a eu comme ennuis ! On a donc rejoint Damas où se sont retrouvées deux unités aériennes, la mienne et celle commandée par le commandant Jean Astier de Vilatte, qui avait participé aux opérations du Fezzan, d’Abyssinie et de Cyrénaïque. Ces unités ont formé la base du groupe de bombardement « Lorraine », deuxième unité de FAFL après le groupe de chasse « Alsace ». Le groupe est alors devenue une unité autonome au sein de la Royal Air Force, dénommée « squadron 223 » faisant partie d’un wing4 avec deux autres escadrons britanniques. Le groupe « Lorraine » reçoit
alors des Bleinheim
avant de
repartir au front. A ce moment, les Britanniques
reprennent l’offensive. Le front est fluctuant
et les appareils opèrent depuis des pistes
sommaires de sable. Le groupe « Lorraine » a
suivi le mouvement des troupes au sol et
bombardé des unités de blindés adverses sous la
menace de la DCA et de la chasse adverse. A l’armistice, l’armée de l’air connaît l’une de ses transformations les plus radicales en passant de 145 000 à 50 000 hommes. Elle aide au rapatriement dans leur pays des Français exilés ou déportés. Vous-même passez du bombardement au transport. Comment avez-vous vécu cette période charnière ? Après l’armistice, on n’avait évidemment plus besoin d’autant d’unités de bombardement. J’ai donc été affecté dans une unité de transport aérien. Au moment de la création du Groupement des moyens mixtes de transport aérien (GMMTA), l’objectif était de rouvrir les premières lignes avec les colonies françaises qui avaient été coupées pendant la guerre. Avec des DC3 Dakota, on a effectué les liaisons vers l’Indochine, Madagascar et l’Afrique du Nord. Il nous fallait trois jours pour rejoindre l’Indochine, en faisant étape à Karachi et à Calcutta entre deux vols de vingt-quatre heures. Cette étape de ma carrière m’a bien servi pour la suite… Propos recueillis par le Colonel Bruno Mignot et le Lieutenant Aurélien Poilbout le
15 octobre 2014
|
|||||||||
|
Nous venions de rentrer d’Algérie ou nous avions combattu le FLN et début mars 1962 nous sommes allés protéger la conférence d’Evian, ou FLN et Gouvernement français échangeaient sur le cesser le feu. C’est ainsi que nombre de pilotes de la «5» se sont retrouvés sur SIPA 12 au-dessus d’Evian, « Grandeurs et servitudes ». Jean Hauviller , contrôleur d’opérations aériennes (promo 54 de l’école de l’air) nous rappelle cet épisode de la DA, prémisse des protections aériennes perfectionnées des grands évènements politiques. La
première « bulle » de la D.A. Face à l’émergence de menaces diverses et variées, l’Armée de l’Air a régulièrement été amenée à mettre en œuvre, dans les décennies passées (avec une nette augmentation depuis les tragiques événements du 11 septembre 2001) des Dispositifs Provisoires de Sûreté Aérienne (DPSA), plus connus, de nos jours, sous l'appellation de «bulles . L’auteur s’est replongé dans ses souvenirs pour partager avec les lecteurs du Piège la mise en place et le fonctionnement de ce qui constitua probablement la première «bulle» de notre Défense Aérienne En 1962, il est convenu que des négociations se dérouleront entre la France et le FLN au mois de mars ; la rencontre aura lieu à l' Hôtel du Parc à Evian . Il est décidé d'assurer la sécurité des conférents contre la menace éventuelle d'un aviateur factieux qui lancerait une bombe afin de troubler la sérénité des discussions, ce qui serait, évidemment, un mauvais point pour nous. La réalisation du dispositif est confiée à l'état major de la Zone Aérienne de Défense Sud (ZAD Sud) situé à Aix les Milles : Le Poste de Commandement Air (PCA) et une petite Station Radar de Campagne du type ANTPS 1D sont installés à Amphion les Bains (à quatre kilomètres d' Evian) ; ce radar, d'une technologie déjà ancienne, était utilisé sur la Base Aérienne 725 de Chambéry pour l'instruction (on met ce qu'on a en rayon). Le chef du PCA est un officier supérieur de l' état major de la ZAD Sud . Les contrôleurs d'interception sont deux lieutenants successivement détachés par le Centre de Détection et de Contrôle 10/912 de Giens ; ils sont assistés par quelques opérateurs. La couverture aérienne sera fournie par les SMB2 de la 5 et par les Vautour II N du 2/30 décollant d'Orange, mais surtout par des SIPA 12. En 1962, les seuls SIPA demeurant en service sont ceux du Centre d'Entraînement des Réserves Ordinaire d' AIX les Milles (CERO 303) ; sept ou huit de cesavions sont déployés à Chambéry. Ils sont mieux adaptés que les « jets » à la menace imaginée, mais quelques passages de ces jets à très basse altitude démontreront à d'éventuels malveillants qu'une musculature plus élaborée participe aussi aux événements. Les pilotes des SIPA sont presque essentiellement de la 5ème EC ; on choisit ceux qui ont une connaissance des avions à hélice récemment acquise en Algérie ; autre avantage de ce choix, ils ont une excellente expérience dans la pratique délicate des mesures actives de sûreté aérienne. La Base de Chambéry est chargée du support vie et technique du PCA et des SIPA. Un détachement motorisé de l'Armée de Terre armé de mitrailleuses lourdes protège la DZ où doit se poser l'hélicoptère transportant les négociateurs du FLN qui passent la nuit en Suisse ; leur ouverture du feu dépend du chef du PCA. Enfin, un Notam international interdit momentanément le survol d'Evian dans un rayon de quelques kilomètres. Le premier contact de l'officier contrôleur avec « son » radar est déprimant : celui-ci est parfaitement aveugle ! Evidemment, l'installation un peu hâtive, d'un radar à effet de sol dans une zone montagneuse ne pouvait guère produire autre chose que des échos … de montagnes ! Les mécaniciens de Chambéry sont promptement ramenés sur les lieux pour parfaire leurs réglages et la situation s'améliore un peu ; mais la surveillance aérienne demeurera difficile, la compétence du contrôleur devant notamment pallier l'absence d'altimétrie et d' IFF. Les opérations commencent le 7
mars et durent jusqu'au 19 ; pendant ces
journées, des couvertures aériennes sont
lancées : quatre patrouilles légères de SMB
2, vingt cinq de SIPA et dix sorties de Vautour. Le 9 mars, un avion inconnu survole Evian, le radar le fait intercepter par «Caniche Bleu», une patrouille de deux SIPA . Toute la chaîne de contrôle tactique est actionnée jusqu'à la Haute Autorité de Défense Aérienne : ordre d'arraisonnement, de tir de semonce... Hélas ! confesse le chef du PCA «... ça n'avait pas été bien glorieux...» car les SIPA n'avaient pas pu tirer, leurs mitrailleuses s'étant enrayées ! Enfin, le Beechcraft suisse intrus, contraint par les SIPA se pose à Ambérieu … ou à Chambéry (peut-être qu'un lecteur du «Piège» s'en souvient ?) où il est accueilli par des gendarmes. Son pilote avoue qu'il vient de Genève et qu'il survolait le lac Léman, qui appartient aussi aux Suisses comme chacun le sait, qu'il n'a pas lu le Notam, qu'il s'est posé sur le premier terrain venu parce que les chasseurs français lui faisaient peur et qu'il a déposé plainte par radio auprès du contrôle de Genève pour manœuvres dangereuses de la part des pilotes français. On raconte qu' il a été libéré peu après, suite à l'intervention d'un diplomate suisse ayant surgi au PCA pour assister son ressortissant. Nous n'avions, en effet, pas grand-chose à lui reprocher ; l'affaire avait toutefois pris une certaine ampleur puisqu' elle avait motivé une entrevue ultérieure entre le ministre suisse de l'aéronautique et le Général ZADS qui avaient conclu que le pilote suisse était coupable et que sa plainte à l'égard des pilotes militaires n'était pas fondée. Un autre événement «singulier» a animé cette opération. Un matin, un hélicoptère non annoncé suit celui amenant la délégation FLN ; manquant d'information pour clarifier cette situation dangereuse, le chef du PCA retient néanmoins les artilleurs qui ont le doigt sur la détente. Heureusement, car on constate à son atterrissage, près du PCA, qu'il s'agit du trésorier de la base de Chambéry venu régler quelques problèmes de finances. Enfin bref, certains de la base aérienne constatent alors qu'une rafale des «pains» est sans doute moins douloureuse que des obus ! On pourra noter, peut-être avec ironie, qu' au cours de cette opération Evian, paradoxalement, la plupart des participants ont eu à protéger des membres du FLN qu'ils avaient combattus peu auparavant (Grandeur et Servitude...) Conclusion essentielle : mission accomplie, puisque rien de grave n'est arrivé. Mais on retiendra surtout que la première bulle de la DA a eu lieu à Evian, il y a bien longtemps !
|
|||||||||
Amie, ami, Notre prochaine sortie culturelle avec les conjoints nous permettra de découvrir le vendredi 20 Mars 2015 Le Musée départemental "Arles antique" Rendez vous chez à 11 h 15 au Musée, Avenue 1ère Division de la France libre – Presqu'ïle du Cirque romain (04 13 31 51 03). Le Musée en 15 chefs-d'œuvre : pour une première découverte des œuvres majeures qui constituent la collection du musée (buste présumé de Jules César, maquettes des monuments, sculptures, mosaïques, sarcophages). Les dernières découvertes du Rhône et la présentation du chaland gallo-romain Arles-Rhône3. L'occasion de suivre les grandes étapes de ce projet exceptionnel : la fouille et le relevage du chaland, la construction de l'extension et la présentation des objets archéologiques autour des thématiques du commerce, du port et de la navigation. Début de la visite : 11 h 30 – horaire impératif – fin 13 h 00 Vers 13 h 30: repas à la Brasserie "Le Malarte" à Arles; 2, boulevard des Lices (04 30 96 03 99) Le parking "du Centre" est à une centaine de mètres en amont du Restaurant, boulevard des Lices. Le
prix de cette journée, visite + restaurant est
de 25 € par personne. Les réservations sont à
adresser pour le 13 mars , dernier délai à: M. DIEU JacquesRés. « Les Baronnettes »174, Avenue de l’Arc de Triomphe84100 Orange
-------------------------------------------- Bulletin de liaison de
l’Association des personnels de la
« 5 » – N 66° – Octobre 2014 |
|||||||||
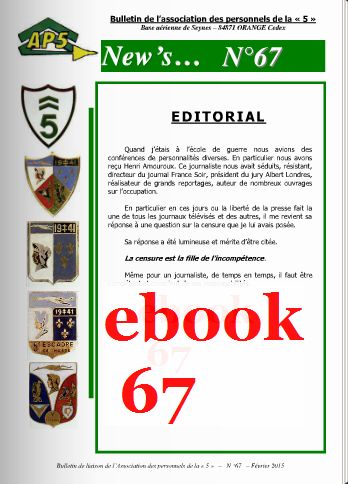 |
|||||||||
En mode plein écran la lecture est plus aisée, vous n'avez pas la publicité. |
|||||||||
| |
|||||||||